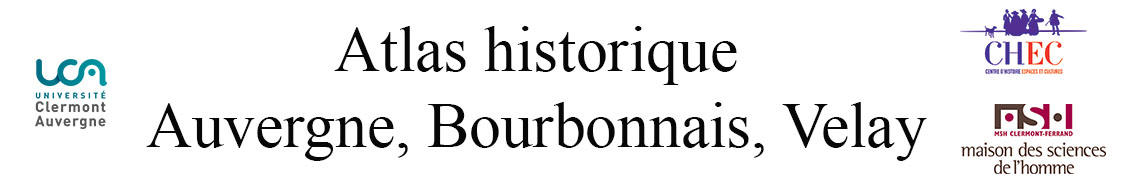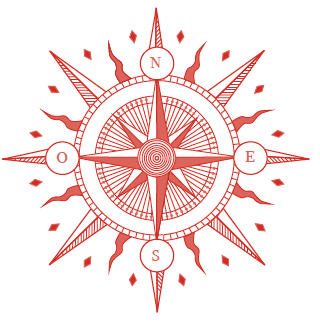
Les circonscriptions électorales à l’époque contemporaine
Les circonscriptions électorales législatives sont un cadre contemporain de découpage du territoire, à la fois intermittent et mouvant. Leur dessin entre en dialogue avec les structures territoriales de plus longue durée que sont les départements, les arrondissements pour l’essentiel et les cantons, en démultipliant les combinaisons.
Des découpages imposés par les scrutins uninominaux
Ces découpages électoraux ont été initiés en 1820. Les nouvelles règles de désignation de la Chambre des députés adoptées cette année-là (« loi du double vote ») ont en effet instauré le recours à des scrutins législatifs uninominaux (pour 247 députés à élire dans le cadre de circonscriptions, territoires infra-départementaux) tout en les faisant cohabiter avec des scrutins plurinominaux départementaux (pour 183 députés, élus par le quart le plus riche des électeurs, votant deux fois). Cette juxtaposition de deux modes de scrutin n’est pas allée au-delà de 1831. En revanche, le scrutin uninominal a dès lors été la règle dans une majorité d’élections législatives. Les phases de retour à un scrutin plurinominal ou « de liste » dans le cadre départemental n’ont guère duré : Seconde République, quatre élections de la IIIe République sur dix-sept (1871, 1885, 1919, 1924), 1945 (Assemblée constituante), IVe République, et pour la Ve République, 1986.
Un projet antérieur de scrutin uninominal, celui de 1815 non mis en œuvre, avait prévu un député par arrondissement, ce qui n’aurait pas nécessité de redécoupage spécifique. Mais dans tous les autres cas, le nombre total de parlementaires prévus différait de celui des arrondissements français. Il était donc nécessaire, chaque fois, de configurer de nouveaux espaces spécifiques, en respectant toutefois l’enveloppe départementale. Les arrondissements ont pu parfois servir de référence, en les fusionnant ou en les divisant. Deux régimes cependant se sont particulièrement affranchis de la prise en compte des limites administratives intra-départementales : le Second Empire et la Ve République (la Restauration ne l’a fait que de façon bien plus mesurée).
Or le découpage influe sur l’équité de la représentation : plus il s’affranchit des limites administratives existantes, plus il est en mesure de produire des circonscriptions relativement équivalentes en nombre d’électeurs et/ou d’habitants (1852, 1958), égalisation initiale qui vole toutefois en éclat si, comme sous la Ve République, le découpage n’est pas revu avant plusieurs décennies ; plus il respecte, au contraire, les limites existantes, plus les distorsions sont marquées (IIIe République). Si pour le Puy-de-Dôme et l’Allier, les deux départements les plus peuplés, l’écart par rapport à la moyenne régionale du nombre d’habitants par circonscription est resté, dans la très grande majorité des redécoupages, contenu en dessous des 10 %, la population de Haute-Loire a été généralement sous-représentée (un député représentant entre 10 et 20 % d’habitants en plus, par rapport à la moyenne), alors que la population cantalienne s’est trouvée sur-représentée. Pour ces « petits départements » plus faiblement peuplés, l’ajustement est tout simplement plus difficile à opérer : accorder ou supprimer un siège de député a, par simple effet mathématique, un impact majoré sur le nombre d’habitants ou d’électeurs que représente chacun.
Ces distorsions ne sont pas étrangères au grief récurrent fait aux découpages électoraux : celui de la partialité. Il est aisé en effet de pratiquer une « géographie électorale active » essayant de concevoir un découpage propre à favoriser son propre camp politique. D’où l’envoi récurrent de signaux, pour tenter de convaincre d’un souci d’équité : c’est le Second Empire redécoupant avant chaque élection pour tenir compte des évolutions démographiques ; c’est la IIIe République choisissant à rebours de prendre l’arrondissement comme cadre de base du découpage, par rejet des soupçons de manipulation du régime précédent via ses reconfigurations pré-électorales.
Négocier avec le cadre spatial de l’arrondissement
Les découpages généraux de 1820-1821 et 1831 sont les seuls à avoir été réservés à un électorat censitaire, sélectionné pour sa richesse, avec un vote étalé sur plusieurs jours, facilitant les intrigues. Le nombre de circonscriptions varie globalement du simple au double entre les deux dates, puisqu’en 1831 il y a abandon du double vote, tous les députés étant désormais élus au scrutin uninominal dans le cadre d’un territoire infra-départemental. En 1820, dans trois des quatre départements, les arrondissements ont joué un rôle malgré tout déterminant dans l’élaboration de la carte des collèges électoraux, opérant par fusions (Moulins et Lapalisse, Montluçon et Gannat, Ambert et Thiers, Aurillac et Mauriac, Murat et Saint-Flour) ou par conservation pure et simple ailleurs dans le Puy-de-Dôme. Seule la Haute-Loire a reçu un traitement distinct, en étant partagée en deux par un axe nord-sud, suivant des limites de cantons, cette limite étant même légèrement déplacée en 1827. Ici, contrairement au Cantal, l’existence de trois arrondissements et non de quatre écartait sans doute la solution de la fusion de deux d’entre eux, qui aurait provoqué un déséquilibre. En 1831, dans l’Allier, le Cantal et la Haute-Loire, chaque arrondissement élit un député et constitue donc un collège. En revanche, dans le Puy-de-Dôme, dépassant de beaucoup le seuil de 70 000 habitants par arrondissement en moyenne, ceux de Clermont-Ferrand et de Riom sont divisés, donnant chacun deux collèges, l’un autour de la ville-centre, l’autre regroupant le reste de l’arrondissement (en deux parties disjointes pour Riom, de part et d’autre de la circonscription centrale – car il avait été décidé de ne pas fragmenter les cantons). Isoler le vote urbain pouvait être en effet, pour les libéraux à la manœuvre, un moyen de favoriser l’élection d’un député issu de leurs rangs.
Le Second Empire, en fixant pour objectif de disposer de circonscriptions de 35 000 électeurs environ, à redécouper après chaque recensement pour tenir compte des évolutions démographiques, s’extrait de la référence aux limites d’arrondissements et s’octroie la possibilité de manipulations récurrentes. L’Allier paraît au départ faire exception, en retrouvant son découpage de 1820, se contentant de fusionner les arrondissements deux par deux. Mais il est le seul des quatre départements considérés à subir deux redécoupages, en 1857 (troisième député) et 1863, la circonscription autour de Montluçon – l’espace industrialisé en pleine croissance – ne cessant de s’agrandir, et l’arrondissement de Gannat étant disloqué pour servir de variable d’ajustement entre les trois circonscriptions. Pour les trois autres départements en revanche, la référence aux arrondissements disparaît bien, dès le départ. La Haute-Loire retrouve une séparation nord-sud. Dans le Cantal, la région d’Aurillac est élargie à quelques cantons de l’arrondissement de Mauriac, au nord, tout le reste, moins densément peuplé, étant fusionné en une seule circonscription, préfigurant le découpage de la Ve République. Dans le Puy-de-Dôme, la ville-même de Clermont-Ferrand est scindée en deux circonscriptions se prolongeant loin dans les zones rurales, mordant même largement sur l’arrondissement d’Issoire, selon un schéma plusieurs fois répété à l’époque pour atténuer le poids politique d’un électorat urbain réputé plus « avancé ». Avec les deux tiers des circonscriptions initiales restées inchangées sous le Second Empire, contre le tiers seulement au niveau national, l’espace étudié est resté tout particulièrement stable, mais cela peut illustrer d’abord sa faible dynamique démographique, mis à part dans l’Allier (+ 12 % d’habitants, et le seul à être régulièrement redécoupé).
La IIIe République – mis à part lors des courtes phases de retour à un scrutin départemental, en 1871, 1885, 1919 et 1924 – a marqué le retour au principe du scrutin d’arrondissement, quitte à scinder ce dernier, sans modifier ses limites extérieures, lorsque sa population dépassait les 100 000 habitants. Ce fut le cas pour les arrondissements de Montluçon, Moulins, Riom, Clermont-Ferrand, Le Puy, mais avec un sort contrasté réservé aux villes-centres : soit scindées entre deux circonscriptions (Moulins, Montluçon ; Le Puy par intermittence, Clermont-Ferrand après le redécoupage de 1927), soit isolées dans une circonscription particulière (Riom, Clermont avant 1919, Le Puy par intermittence). Ici, les stratégies ont pu jouer au cas par cas avec des configurations politiques contrastées. Au cours de la dernière phase de scrutin départemental (1919-1928), sont toutefois supprimées, en 1926, 106 arrondissements dans le pays ; chacun des départements de l’espace étudié en perdant un (Gannat, Murat, Yssingeaux, Ambert). Le nouveau découpage électoral, juste postérieur, entend « respecter les habitudes de l’électorat » et conserver les circonscriptions correspondant à des arrondissements disparus. Toutefois, en Haute-Loire et dans le Cantal, les deux départements les moins peuplés, la reconduction n’est pas totale : dans le premier cas, les anciennes limites d’arrondissement entre Le Puy et Monistrol n’ont pas été suivies, tout en s’appuyant sur des limites cantonales ; et dans le second, Murat n’a plus eu de député, le partageant avec Saint-Flour. Ces ajustements par rapport à la logique mettant en avant l’arrondissement sont les seuls intervenus, avec l’octroi d’un huitième député au Puy-de-Dôme. L’écart de représentativité de l’électorat de chaque circonscription par rapport à la moyenne nationale s’est donc aggravé au cours de la IIIe République, pendant laquelle la population des zones rurales a fortement décru.
Les découpages de la Ve République, renouant avec l’objectif de répartition équitable de l’électorat, n’a pas totalement fait abstraction pour autant des limites d’arrondissements. Celles-ci sont restées prégnantes dans le Cantal et le Puy-de-Dôme : arrondissement d’Aurillac augmenté d’abord de deux cantons, puis réduit à lui-même, face au reste des arrondissements de Mauriac et Saint-Flour fusionnés ; arrondissements de Thiers et Ambert fusionnés, de Riom laissé intact, et transferts limités de cantons entre ceux d’Issoire et de Clermont-Ferrand, ce dernier étant scindé en deux, puis trois, en partageant l’agglomération centrale. L’Allier et la Haute-Loire en revanche s’en émancipent, mais avec réunification des villes de Montluçon et de Moulins, là où il y a scission de celle du Puy.
Le respect globalement fort des limites administratives héritées, ainsi que la fréquence somme toute modérée des redécoupages intermédiaires sont sans doute des effets du faible dynamisme démographique de la région (sauf, un temps, dans l’Allier), combiné avec la force du maillage administratif comme cadre de la vie socio-politique. Pour autant, le poids de l’électorat auvergnat n’est pas globalement majoré comme on pourrait s’y attendre dans une région qui se dépeuple : en situation de scrutin uninominal, le Second Empire et même la IIIe République débutante arrivent à produire ici une représentativité des circonscriptions proche de la moyenne nationale ; sous les régimes censitaires et, plus étonnamment, au début de la Ve République, le poids des électeurs auvergnats est en revanche minoré de façon significative, mais dans ce dernier cas l’augmentation plus vive de la population hors de la région a réduit progressivement l’écart.
Bibliographie
Jean-Marie Cotteret, Claude Emeri, Pierre Lalumière, Lois électorales et inégalités de représentation en France, 1936-1960, Paris, Armand Colin, Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques, 107, 1960.
Bernard Gaudillère, Atlas historique des circonscriptions électorales françaises, Genève/Paris, Droz/Champion, 1995.
Marie-Thérèse Lancelot, Alain Lancelot, Atlas des circonscriptions électorales en depuis 1875, Paris, Armand Colin, Cahiers de la Fondation nationale des sciences politiques, série « Atlas », 1970.
Robert Ponceyri, Le découpage électoral, Paris, Economica, 1988.
Frédéric Salmon, Atlas électoral de la France, Paris, Le Seuil, 2001.